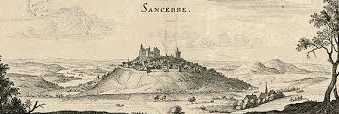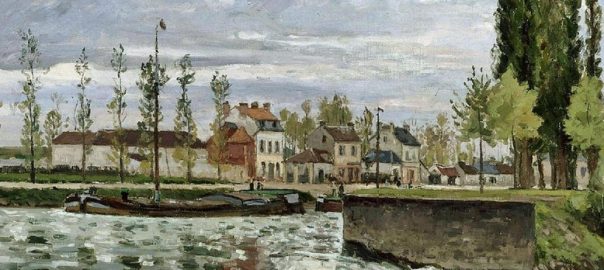(Illustration : Camille Pissaro : "Ecluse sur l'Oise")
Il s’en est fallu de peu que Donzy ne devienne au XVIIIème siècle un port fluvial !
Un certain Amelot avait conçu vers 1700 le projet d’un canal de la Loire à l’Yonne, empruntant notamment le cours du Nohain, à partir de Cosne. Cette voie aurait permis de transférer des marchandises qui descendaient le cours de la Loire vers le bassin de la Seine et Paris, et d’y acheminer les productions du Nivernais et du Morvan. La « Fourniture de bois à destination de Paris » une activité qui mobilisait bien des énergies dans les hautes vallées de l’Yonne et de la Cure depuis le XVIème siècle, mais subissait les contraintes du « flottage », en aurait été sensiblement améliorée. Les productions métallurgiques aussi auraient trouvé de nouveaux débouchés.
Pourtant ce projet ne vit jamais le jour.
C'est qu'il n’avait pas que des amis et ses détracteurs rivalisaient d’arguments de plus ou moins bonne foi pour en contester la pertinence.
En Gâtinais et en Orléanais on voyait le canal de Cosne comme un concurrent potentiel de ceux de Briare, d’Orléans et du Loing. Le duc d’Orléans, qui exerçait le pouvoir suprême au moment même où le projet était sur la table, appuyé par un puissant réseau d’influence, se posa en protecteur de ces ouvrages, qui alimentaient sa cassette.
Il n’est pas certain que les maîtres de forges du Donziais y aient été plus favorables. Car un tel aménagement aurait capté une part du débit du Nohain et de ses affluents, au détriment de l’efficacité de leurs usines au fil de l’eau.
Il faut admettre enfin que son activité aurait été de courte durée, puisque le déclin du bois de chauffage et celui de la petite industrie métallurgique étaient imminents.
C’était cependant un beau projet et il eut changé radicalement l’aspect du pays !
Léon Mirot, historien clamecycois et archiviste, en a raconté l’histoire dans une brochure parfaitement documentée : « Projets de jonction de la Loire et de l’Yonne ; le canal de Cosne à Clamecy » (Paris, Nevers, 1907).
Les « Annales des Pays Nivernais », dans leur livraison consacrée à Donzy (Camosine, Nevers, n° 153, 2013), évoquent ce projet.
Son porteur principal et presque unique, Jean-Baptiste Amelot (1674-1742), ingénieur des Ponts-et-Chaussées, était le fils d’un marchand de Cosne. Devenu « seigneur de la Roussille » près d’Entrains (voir l'article correspondant), en surplomb des sources du Nohain justement, il fut connu comme « Entrepreneur des travaux du Roi ». Il se remaria en 1718 avec la fille d’un huissier du Châtelet de Paris et en eut des enfants, dont l’un, Jean-Henri, Contrôleur des droits réunis en Languedoc, lui succéda dans l’entreprise.
Amelot avait obtenu l’appui d’un puissant personnage : le maréchal d’Estrées, Amiral, Grand d’Espagne, Gouverneur de Nantes et Vice-Roi d’Amérique, qui fut son défenseur au Conseil du Roi et son associé un temps. « Le maréchal d'Estrées et l'abbé son frère étaient honnêtes gens » écrit Saint-Simon, « et tout-à-fait portés à M. le duc d'Orléans, mais si faibles, si courtisans, si timides, qu'il y avait à rire de leurs frayeurs ».
Amelot en obtint des lettres patentes pour la création de la société du canal le 27 juin 1719. Elles furent aussitôt contestées et n’entrèrent jamais en vigueur, malgré 23 ans de débats techniques et judiciaires, qui laissèrent Amelot amer et ruiné. L’arrêt définitif du Conseil du Roi du 22 avril 1742 finit par « faire défense aux promoteurs du projet de construire le canal de Cosne, ni de troubler directement ou indirectement M. le duc d’Orléans… ».
Le projet refit surface pendant la Révolution, à l’initiative des héritiers du fondateur, son fils et son gendre. Mais un nouvel examen du dossier mit à nouveau en évidence la nécessité de préserver l’activité des nombreux moulins et d’assurer la navigabilité de l’Yonne jusqu’à Auxerre, ce qui le rendait improbable. Il s’enlisa à nouveau.
Le parti d’aménagement était pourtant fort simple puisqu’il s’agissait, pour l’essentiel, d’utiliser la vallée du Nohain qui offre une pente douce et régulière sur 45 kms, de Cosne à Entrains où il prend sa source. La seule difficulté consistait à franchir ensuite le seuil qui sépare cette vallée d’Etais-la-Sauvin, pour rejoindre le cours du ruisseau d’Andryes qui rejoint l’Yonne à Surgy.
Lors de la réactivation du projet en 1790, on imagina même une variante qui aurait obliqué vers le sud à Entrains, pour rejoindre après un seuil le ruisseau de Corbelin et le Sauzay, et atteindre Clamecy par Corvol-L’Orgueilleux.
Autant vaut dire qu’à l’image du Nohain qui en est l’âme, ce canal aurait été éminemment Donziais. Il aurait transformé le pays et serait devenu de nos jours un excellent vecteur touristique. On aurait visité la forteresse de la Motte-Josserand, le prieuré de Notre-Dame-du-Pré ou le château des Granges depuis les escales fluviales. Des ports à Etais, Entrains, Donzy, auraient animé ces petites cités, sans parler de Cosne dont la vocation de carrefour eut été renforcée.
Mais ce canal resta une chimère ; le flottage du bois a cessé ; le bruit des martinets s'est tu. Heureusement le Nohain, belle rivière sauvage, ne cesse de nous enchanter.