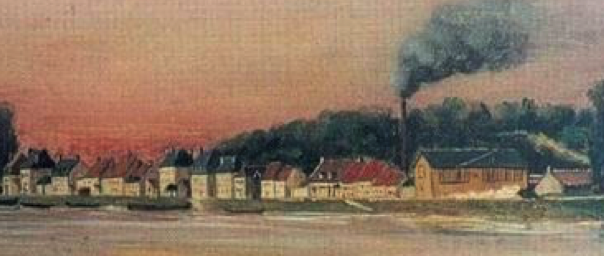(Ilustration : crypte de l'abbaye Saint Germain d'Auxerre)
A Moutiers-en-Puisaye, non loin de Saint-Sauveur, il ne reste que quelques ogives et chapiteaux enchassés dans les murs de bâtiments agricoles du village comme trace de l'ancien prieuré bénédictin.
Une abbaye-hospice avait été fondée là vers 700 par le seigneur Quintilien, dont le fils du même nom fut évêque d'Auxerre, en particulier pour accueillir les pèlerins bretons (irlandais, gallois) qui se rendaient à Rome. Il s'agissait peut-être d'un ancien site druidique si l'on en croit les traditions locales. Très vite le monastère demanda et obtint la protection de la grande abbaye de Saint Germain à Auxerre et lui fut rattaché en 864. Il fut dès lors un simple prieuré, mais doté dès l'origine de grands biens en Puisaye.
L'évêque Hugues de Chalon, qui compte tant dans l'histoire du Donziais, accepta de lui confier le corps d'un illustre prédecesseur du VIIIème siècle : Saint Didier, qui y rejoint bien d'autres reliques, et fut à l'origine de nombreux miracles.
Raoul Glaber, le fameux chroniqueur de l'An Mil, y fut moine avant de rejoindre Saint-Germain.
A Moutiers comme en bien d'autres sites, les ravages de la guerre de Cent ans, la mise en commende de l'abbaye mère, et les exactions des huguenots et de leurs mercenaires allemands à la fin du XVIème, eurent raison du brillant prieuré. Ses églises, dédiées à Notre-Dame et à Saint Germain, et son cloître, disparurent complètement aux XVIIème et XVIIIème siècles, et ses bâtiments conventuels, où une communauté de 24 moines avec leurs serviteurs avait vécu au Moyen-Âge, furent réduits à l'état d'exploitation agricole.
Le domaine lui-même fut progressivement dispersé et racheté par des seigneurs des environs (du Deffand, Le Peletier…etc) et ce qui restait de la vieille abbaye fut vendu comme Bien National.
Heureusement le souvenir de ce haut lieu est entretenu par la présence à Moutiers d'une église paroissiale romane exceptionnelle, qui fut une dépendance du prieuré, et qui abrite des peintures murales médiévales remarquables, retrouvées à l'époque contemporaine et restaurées.
Ci-dessous une notice sur l'histoire de ce monastère :